
Introduction
Une enquête d’utilité publique a été ouverte le 27 juin 2019 jusqu’au 20 août 2019 par arrêté préfectoral pour « un projet de modernisation de la station des eaux usées MAERA présenté par Montpellier Métropole », soit une durée de 44 jours, en plein été, en pleines vacances ! Les association vigilantes ont réussi à persuader les autorités de prolonger la dite enquête jusqu’au 4 septembre 2019, 18 h. L’ODAM a pu, à la fin août, consulter le registre dématérialisé et son dossier et rédiger une contribution dont nous donnons la teneur ci-dessous. Le Président de l’ODAM a rencontré les commissaires enquêteurs le 4 septembre de 9h15 à 10h15 pour un échange cordial et constructif. Nous espérons avoir été écoutés et entendus.
Contribution de l’ODAM
Montpellier le 2 septembre 2019
EUP modernisation Maera
Objet : « Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA, sur la commune de Lattes, lieu dit la Céreirède, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole » (arrêté préfectoral n°2019-I-743 du 17 juin 2019).
Nous sommes solidaires de tous ceux qui ont protesté sur la date de tenue de l’enquête pendant le début de l’été et des vacances, nous sommes gré de la prolongation au 4 septembre. Sans cette prolongation, l’enquête aurait pu être interprétée comme une tentative de « passage en force » dont Montpellier-Méditerranée-Métropole nous a déjà habitués dans le passé, pour d’autres aménagements aujourd’hui controversés.
Il s’agit de donner un avis sur l’utilité publique du projet de Montpellier-Méditerranée-Métropole qui présente un « projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées [STEP] Maera ». S’agit-il vraiment de « moderniser » cette STEP qui dessert à l’heure actuelle 14 communes de la métropole et 5 hors-métropole ?
Préambule
Le concept de modernisation est totalement différent de celui d’extension. Il ne s’agit pas de la même chose. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » écrivait Albert Camus (L’homme debout, Edition II).
Nous déclarons que l’eau usée, certes, est un déchet mais un déchet précieux qu’il convient de recycler, de récupérer et d’épurer correctement en vue de sa réutilisation en eau douce à toutes les fins agricoles. Les exutoires fluvial (Le Lez) ou marin (golfe du Lion-golfe d’Aigues-Mortes), tel qu’il fonctionnent depuis 1965, sont une dangereuse hérésie, un crime contre l’environnement. En 2005, se tenait une conférence publique (28/04/2005, Montpellier) dénonçant la conception de la nouvelle usine qui allait s’ériger sur le site de la Cérereide obsolète (rejetant dans le Lez depuis 1965). Cette « usine pilote », selon l’expression de son promoteur, allait remplacer la Cérereide, mais en améliorant le traitement et en déportant la pollution du Lez dans le golfe d’Aigues-Mortes, à 11 km au large de Palavas, par un émissaire de 20 km dont 11 en mer. Le débit du rejet prévu est de 130.000 m3/jour (soit environ 1,5 m3/s). Ce contre quoi ont protesté à l’époque les associations de défense de l’environnement, notamment celles de la baie d’Aigues-Mortes ou des communes riveraines du Golfe. Une protestation contre la composition des effluents prétendument traités à 95% :
- des MEST[1] (matières en suspension : 3,5 t/jour de MEST),
- des DBO[2] et des DCO[3] (ces deux derniers appauvrissent le milieu en oxygène),
- plus des ions de composés d’azote, phosphore,
- des médicaments humains rejetés avec les selles, certains radioactifs,
- des PCB, etc.
- sans compter une impressionnante quantité de germes coliformes !
Le taux d’épuration justifiait, selon Montpellier-Agglomération et un avis de 1996 d’un « comité national d’hygiène » approuvant un rejet en mer, au large, avec comme excuse supplémentaires qu’un courant dit « Ligure » allait balayer ces substances et les diluer dans la grande masse de l’eau de la Méditerranée, affirmation justifiant ce que nous qualifions comme « atteinte grave contre l’environnement », dans la mer la plus polluée du monde, souffrant de la pollution de toutes les grandes métropoles françaises riveraines comme de celles étrangères (celles du sud-est en particulier). L’influence de ce courant Ligure n’aurait jamais été scientifiquement démontrée comme du reste, l’effet de dilution de la pollution rejetée.
Nous sommes solidaires des communes situées à l’est de Palavas, qui n’ont pas été associées comme partie prenante dans l’élaboration de l’enquête, au prétexte qu’elles appartiennent à un département voisin. Un écosystème peut recouvrir plusieurs divisions administratives, l’écosystème du golfe du Lion et de la baie d’Aigues-Mortes ne peut être réduit à sa partie faisant face à l’Hérault, ce qui n’est pas naturel. Les limites administratives ne constituent en aucune façon une barrière anti-pollution : la pollution est trans-frontières, encore plus s’agissant de la mer ! La compétence se devait d’être étendue à tout l’écosystème, au moins à l’est de la Grande-Motte et à l’ouest de Palavas.
L’émissaire en mer (coût = 65 Millions d’€uros)
Le 16 novembre 2018, s’est produit un incident survenu sur l’émissaire, exutoire en mer de Maera : une rupture de la canalisation au lieu dit « les 4 canaux » à Palavas dont aucun média n’a rendu compte mais qui a fait l’objet d’un constat d’huissier de justice. Les effluents seront pompés de la fouille de dégagement et sont déversés dans l’étang du Prévost, tout le temps que dureront les travaux de réparation de la fuite. Cette réparation s’est faite par un « sanglage » (provisoire ?). Cet incident à lui seul montre la dangerosité du dispositif de rejet en mer chaudement recommandé en … en 1996 ! Depuis, la science a fait des progrès notamment sur le devenir des polluants en mer et sur l’état de la mer méditerranée, mer fermée, eutrophisée et très polluée ! Les nouvelles règles européennes sont là, il faut en tenir compte (Fondation Ellen Mac Arthur).
Les traités scientifiques nous disent que l’hydrogène sulfuré qui est contenu dans les tuyaux d’égoûts des réseaux d’assainissement corrodent le béton, l’acier, la fonte. La question se pose sur l’efficacité des dispositifs de désulfuration à la sortie de Maera ? Or, les riverains savent combien ce composé est présent dans les eaux qui empruntent l’émissaire (odeurs méphitiques constatées là où sont placés des évents de cette canalisation. Il y a eu une première manifestation le 16 novembre 2018, combien de microfuites le long des 20 km de cette canalisation ? Les microfuites évoluent et un jour, comme ce 16 novembre 2018, ça casse !
L’émissaire en mer a coûté cher, mais il faudra dans un premier temps stopper progressivement son utilisation (il semble corrodé et le public ignore à quel point). Il faut envisager une vraie modernisation de la STEP Maera pour en faire une vraie station de traitement rejetant, quelles que soient les circonstances météorologiques, de l’eau de qualité baignade dans le milieu naturel. Où devra se faire le rejet ? Dans le Lez pour permettre l’étiage de ce fleuve. Ou en réutilisant une partie du conduit pour amener les eaux vers des jardins filtrants proches du trajet, là où il y a du foncier disponible. Il faut également mettre en place un système d’eau d’irrigation agricole (le Gard est actuellement, au 26 août 2019, en période de sécheresse, de stress hydrique, pénurie d’eau d’irrigation). L’Hérault ne saurait tarder, la pluie n’est pas au programme avant dux semaines. L’étiage du Lez est maintenu par un apport d’eau du Rhône amené par le Canal « Philippe Lamour » (BRL) qui traverse le Gard assoiffé et une partie de l’Hérault. Cet étiage est nécessaire pour compenser le prélèvement d’eau potable dans la nappe souterraine de la source du Lez. On oblige bien des agriculteurs à cesser leurs prélèvements, pourquoi pas cesser la compensation de l’étiage du Lez avec l’eau du Rhône ?
Par ailleurs, nous n’avons cessé de dénoncer l’insouciance des autorités locales (assemblée délibérante des communes et agglo-métropole confondues) qui ont accepté que l’eau sortant de Maera ne soit pas débarrassée de sa charge bactériennne-virale et soit insuffisamment traitée (il manque des rampes de lampes à rayons ultra-violets, une chloration appropriée, etc. : une dépense mineure ?) : la seule protection réside actuellement sur l’interdiction de toute pêche et de toute plongée autour de la sortie de l’émissaire et récemment la suspension administrative d’une conchyliculture impactée. L’eau salée n’est nullement un désinfectant pour les bactéries (coliformes, entérocoques, etc.). Ces bacilles sont censés vivre en mer plus que les 3 jours qu’on leur prête et peuvent revenir vers la côte en cas de vents marins. Les conchyliculteurs apprécieront (dont nous apprenons le préjudice qu’ils ont subi !). Ces bacilles en contact avec les résidus d’antibiotiques des effluents peuvent voir leur dangerosité accrue (piste à suivre). Car, là est le problème de mélange des eaux de l’émissaire peu salées et à faible densité avec l’eau de mer salée et à plus forte densité. L’agitation créée par les « becs de canard » du tronçon terminal en mer tente ce mélange mais l’eau douce remonte en surface et peut suivre les vents soufflant vers la terre, ramenant à la côte des bacilles peu moribonds.
Au modèle Maera, notre association n’a cessé d’opposer le modèle de STEU utilisée par l’agglomération de Caen-la-Mer qui rejette depuis plus de 15 ans, dans l’estuaire de l’Orne, des eaux de qualité baignade correctement traitées, filtrées en finale par des jardins végétaux filtrants de plantes à rhizomes capables de ce travail d’épuration. Montpellier-Méditerranée-Métropole n’a jamais voulu entendre raison sur cette solution. Et, cerise sur le gâteau, on nous propose l’augmentation de la capacité de traitement avec, à terme, une augmentation des déversements en mer via un émissaire dont nous doutons de l’étanchéité.
Conclusion partielle : la modernisation envisagée de Maera semble ignorer les exigences de protection du milieu marin méditerranéen contre toute pollution. Elle est hors de propos avec l’exigence de récupération et réutilisation de l’eau : 130.000 m3/jour en pure perte déversés en mer alors que cette eau pourrait renforcer l’étiage du Lez et servir à l’agriculture. Ceci n’est pas pris en compte dans les documents de l’enquête. Montpellier-Méditerranée-Métropole rejette cette éventualité dans le document « Projet de … : Bilan de la concertation préalable (sd [2018]).
Extension ou modernisation ?
Nous affirmons, à la lecture des dossiers, que le véritable objet de Montpellier-Méditerranée-Métropole n’est pas une modernisation mais une actualisation, réactualisation et extension ave une augmentation de la capacité de traitement de 40% de la capacité actuelle en vue de satisfaire une augmentation de population permanente hypothétique et provoquée sciemment. Depuis ses débuts (Cérereide en 1965), le promoteur (Montpellier … district, agglo, métropole) a visé, au prix de travaux pharaoniques, année après année, à fermer des stations communales (au lieu de les moderniser localement) et à proposer voire imposer des raccordements à Maera en s’attribuant « la compétence assainissement », même à des communes d’autres agglomérations (cinq communes sont hors-métropole : Palavas, p.e.). Cette politique de grands travaux inutiles s’oppose au principe de subsidiarité des traitements de déchets, traitement au plus près du lieu de production. Il existe au nord de Montpellier une station communale exemplaire (Vailhauqués), conçue sur des bases écologiques, utilisant des vers de terre comme agents actifs et déversant ses effluents bien épurés dans la Mosson (le maire de Vailhauqués est un scientifique soucieux du milieu naturel, pas un juriste spécialiste des conflits à venir).
L’extension envisagée (40%) émerge, quand on lit les informations enfouies dans un dossier technique d’un volume monstrueux et quand on détient, depuis 1965, l’historique de Maera-Cérereide : au lieu d’une modernisation, on nous cache essentiellement une réactualisation et une extension. Alors que dans la situation actuelle c’est moins de 400.000 équivalents-habitants (EH) qui y sont connectés, la lecture des dossiers fait état « d’une capacité de 470.000 EH qui serait portée à 660.000 EH », ce qui prouve qu’il s’agit bien d’une extension (augmentation de la capacité de traitement d’un tiers, c’est à dire plus 190.000 EH (+40%). Pourquoi une telle augmentation ?) à laquelle il faut ajouter, à la marge, rénovation et modernisation. Maera fait suite a un échec écologique, environnemental, financier et de conception de sa précédente rénovation, laquelle ne remonte pas à plus de 12 ans. On joue sur les mots, on commet un grossier abus de langage, dans un dossier de plusieurs centaines de pages, une inflation technologique qui a pour but de noyer le citoyen sous un fatras technique, en l’abusant sur le travail de modernisation que nous n’avons cessé de préconiser depuis 12 ans au fil de nos observations lors des visites que nous avons pu faire ou sur notre site Internet (https://www.odam.fr). Ces observations ont été relayées au fil des réunions d’une Commission de suivi de site à laquelle les autorités nous ont, avec constance, refusé toute participation, nos observations ayant déplu à la communauté territoriale concernée malgré leur pertinence. Nous défendons l’intérêt général, nous ne réglons pas des comptes, même si cela déplait aux dépensocrates.
De surcroît, l’extension prévue se fait dans une zone dont le caractère inondable ou non-inondable fait l’objet de controverses.
Augmenter la capacité de traitement de 470.000 EH à 660.000 n’en fera pas pour autant une meilleure station, elle pourrait même être pire dans son impact sur le milieu naturel. Les effluents transitant par un émissaire, dont l’étanchéité est douteuse, vont augmenter. C’est loin d’être un exemple de vertu écologique avec toutes les problématiques centrées sur une même station plus importante en cas de dysfonctionnement.
L’État sanitaire du milieu naturel à l’aval de Maéra
Le document de réponse aux remarques de l’autorité environnementale (AE) met l’accent sur l’amélioration de l’état sanitaire environnemental du milieu naturel notamment des espaces lagunaires situés de part et d’autre du Lez et Palavas. Lors de la mise en service de la nouvelle Cérereide ou Maera (la rolls-royce des STEP ou « une station pilote » disait-on à l’Agglo), il est clair que le fait de ne plus rejeter d’effluents dans le Lez d’où ils gagnaient les étangs, a assaini considérablement le fleuve après une situation catastrophique. Pour les étangs saturés d’apports polluants, l’évolution a été plus lente à venir. Mais l’alibi du rejet en mer à 12 km par l’émissaire a permis l’envoi d’une partie de la pollution (5%) dans une mer qui n’en a pas besoin avec des désordres et des dysfonctionnements non immédiatement visibles rapidement et qui constituent autant de causes cachées de problèmes environnementaux graves à venir.
D’autre part, on a l’impression, à la lecture des documents de l’enquête que l’amélioration de l’environnement de la zone lagunaire est un objectif encore à atteindre ! Pourquoi cet état de fait dont l’incident-accident du 16 septembre 2018 aux 4 Chemins, soigneusement dissimulé, ne serait que la partie visible d’un iceberg fait d’une cascade de micro-fuites invisibles provoquée par une corrosion invisible ?
La traversée d’un des étangs dans une zone vaseuse instable et à caractère oxydant n’est pas faite pour mettre le tube à l’abri de la corrosion extérieure, ce qui est loin de nous rassurer sur l’intégrité générale du conduit.
Le problème des crues et des épisodes cévennols
Un des problèmes que Montpellier-Méditerranée-Métropole propose de régler est celui des forts épisodes pluviométriques (épisodes cévenols ou méditerranéens) qui surviennent en automne-hiver-printemps. Les pluies orographiques se propagent rapidement vers la plaine créant des inondations (on connaît historiquement les crues du Verdanson, affluent du Lez). A la forte quantité d’eau qui tombe s’ajoute un fort ruissellement qui est aggravé par l’imperméabilisation des sols. Les immeubles et leurs parkings font dévaler, depuis les hauteurs de Montpellier et des Cévennes-Causses, des quantités d’eau qui convergent vers Lattes (Negue-Cats, Lez, Mosson, Verdanson, etc.). La partie de l’eau qui s’engouffre dans le vieux réseau unitaire d’égouts arrive en trombe sur Maera malgré le bassin régulateur (insuffisant ) de crues des Aiguerelles. Maera ouvre les « by-pass » et les eaux grises-noires passent dans le Lez proche avec leur charge brute de polluants. Ce phénomène a été longtemps caché au public alors que nous l’avons toujours révélé à la suite d’une visite de la STEP.
On nous affirme que les aménagement prévus vont diminuer les rejets par by-pass, on ne nous affirme aucunement qu’ils seront nuls. Les risques ne tiennent pas compte du changement climatique et de la montée des eaux des océans, montée à laquelle la Méditerranée n’est pas à l’abri.
Un second phénomène se produit lors des épisodes cévenols : les fortes marées qui bloquent l’évacuation des eaux by-passées dans le Lez. Les vents marins soufflant vers la terre ramènent la pollution vers les étangs. Que va faire la Métropole ? La pollution par les coliformes et entérocoques (et les virus ?) rejetés en mer remonte dans des bulles d’eau « douce » et revient vers la terre, vers le lido de Palavas et des communes voisines en moins de 3 heures. Ce ne sont pas 12 km parcourus depuis la sortie de l’émissaire en mer, parcourus en moins de 3 heures, qui suffiront à tuer les germes, n’en déplaise à la Commission nationale d’hygiène de 1996 et à Montpellier-Méditerranée-Métropole.
Nous finirons en rappelant l’existence de la « Directive Cadre Stratégie pour le Milieu marin » (2008/56/CE, DCSMM), directive qui préconise « une mer saine, propre et productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage durable des biens et services associés. ». Tout le contraire de l’innocuité prétendue des rejets en mer d’eaux chargées de bacilles et de virus.
Notre avis final est contre, résolument défavorable à l’extension telle qu’elle nous est proposée (qui laisse de toutes façons Maera avec ses défauts) et ne permet pas de supprimer la totalité des dysfonctionnements et des pollutions, à la fois en mer et dans le Lez : une réalisation industrielle incomplète, ignorant tout de l’écologie, dans une région où la préservation du milieu naturel et de la Méditerranée est une richesse touristique importante qu’il convient de préserver.
Aucune alternative à cet unique projet d’extension n’a été portée à la connaissance du public (et à la nôtre) alors que nous estimons que la meilleure réponse serait la création d’une à deux STEU, l’une au nord-est, l’autre au nord-ouest d’une capacité de 50.000 EH chacune, extensibles à 100.000 (regroupement de villes à proximité) avec récupération des phosphates, le recyclage et la réutilisation des eaux, là où le besoin existe à proximité.
La mer Méditerranée n’a pas besoin d’un apport d’eau dite « douce » polluée, contaminée, alors que l’arrière pays aura de plus en plus besoin d’eau recyclée convenablement et ce, afin d’épargner des ressources en eau souterraines de qualité dont certaines ont été compromises par des décharges d’ordures ménagères prétendument non-dangereuses (ISDND Castries, entre autres, résultat de la politique des déchets de cette même Montpellier-Méditerranée-Métropole).
Le défi du changement climatique et des stress hydriques qui en sont la conséquence ne sont pas des phénomènes situés dans des pays lointains et exotiques. La montée des eaux dans la plaine littorale au sud de Montpellier progresse insidieusement. Ces phénomènes sont là, à notre porte, chez nous, « aquí », sur la côte languedocienne. Il convient de faire le pas et d’arrêter le désastre qui s’annonce.
Sur la forme du dossier, nous faisons remarquer que Montpellier-Méditerranée-Métropole se prévaut de nombreuses dérogations à des dispositions destinées, pour certaines, à protéger l’environnement. Nous soulignons qu’alors cela voudra dire qu’on aura violé toutes les réglementations au profit de dérogations. Les responsabilités des décideurs seront engagées devant les générations actuelles et futures.
Le projet de modernisation de Maéra doit être rejeté et/ou ré-écrit avec un changement complet de paradigme tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques sur le milieu marin, lagunaire et fluvial. La présence de zones naturelles reconnues (ZNIEFF, RAMSAR, etc.) n’est pas à fouler au pied ! Des activités économiques de pêche et de conchyliculture sont impactées, toutes proches comme celles éloignées.
Il se trouve que l’Université de Montpellier enseigne l’écologie tant marine que terrestre depuis plus d’un demi-siècle, adossée à de grands organismes de recherche tant nationaux qu’internationaux (CNRS, IFREMER, INRA, CIRAD, INSERM, etc) : cette excellence vient d’être reconnue en 2019 par une première place au classement dit « de Shangaï ».
Raymond GIMILIO
Président de l’ODAM
Certifié és Chimie
Docteur en sciences biologique mention écologie
Ancien chargé d’études de haut-niveau au ministère de l’environnement (1980-1996)
Ingénieur de recherches (ER) du CNRS
Chevalier du mérite agricole (2015)
[1] Matières en suspension transportées : MEST
[2] matières caractèrisées par leur demande biologique en oxygène : DBO
[3] idem demande chimique en oxygène : DCO
Complément et erratum
Montpellier le 3 septembre 2019
EUP modernisation Maera
complément
Objet : « Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA, sur la commune de Lattes, lieu dit la Céreirède, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole » (arrêté préfectoral n°2019-I-743 du 17 juin 2019).
- Erratum
Le présent document apporte quelques corrections au précédent document versé le 2 septembre. La « commission d’hygiène et de sécurité etc. » dont il est question page 5 doit être remplacée par « Conseil supérieur d’hygiène publique de France qui a émis une prescription en 1994 ».
- Complément d’avis sur le dossier
Nous attirons l’attention des Commissaires Enquêteurs sur l’avis formulé par l’Autorité Environnementale, formation d’autorité du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, nous citons :
« Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations opérées est rendue publique avec la décision d’octroi ou de refus d’autorisation du projet (article L. 12211 du code de l’environnement). En cas d’octroi, l’autorité décisionnaire communique à l’autorité environnementale le ou les bilans des suivis, lui permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des prescriptions, mesures et caractéristiques (article R. 12213 du code de l’environnement). »
C’est un avis mitigé, en tête d’un document de 30 pages daté du 23 janvier 2019. L’autorité s’est déplacée à Montpellier et à Lattes dans la plus grande discrétion médiatique. Le document est clair, facile à lire. Il comporte une synthèse qui recommande des études complémentaires sur :
- Les scénarios de non-débordement,
- L’absence de surverse pour les pluies mensuelles, y compris en saison touristique (apport de population),
- La réalisation d’une première analyse de risques des raccordements de nouvelles installations, etc.
L’avis détaillé met en exergue la surcharge hydraulique de la STEU Maera actuelle, les prévisions d’augmentation de la population, etc.
Nous avons relevé (page 6) les quantités de polluants reçus, il conviendrait d’appliquer un coefficient de 5% pour calculer ce qui est rejeté après abattement, en mer, via l’émissaire. Par exemple pour 32 t/j de MES, ce seraient 1,60 t/jour qui emprunteraient l’émissaire, 28 t/j de DBO5 ce seraient 1,40 t/jour qui seraient rejeté au large, etc. Ces chiffres sont loin d’être anodins et justifieraient une obligation absolue de rejet d’eaux claires, sans MES, DCO, DBO5, etc., une eau récupérable et recyclables qui se perd actuellement en mer via un émissaire qui a coûté le bagatelle de 65 M€. Nous mettons toujours en parallèle la STEU de Caen-la-Mer (capacité comparable) qui rejette à travers des jardins filtrants, ces jardins qui semblent mal connus et mal appréciés par 3M (Montpellier-Méditerranée-Métropole). Ce sont des tonnes par jour qu’on enverrait au large se diluer dans la mer ?
Nous avons apprécié la réponse de 3M : un pavé d’environ 258 pages supplémentaires et nécessaires, qui auraient dû éclairer le public dès le début des premières concertations en 2018.
Le résumé non-technique aurait dû venir en tête des documents du projet. Comment ne pas s’étonner que, devant les pavés indigestes et incompréhensibles pour le commun des mortels, le grand public des citoyens, dans une ville qui affichait son désir de démocratie participative ou de démocratie de proximité, les premières enquêtes et les réunions de concertation aient attiré si peu de participants et aient si peu motivé les médias ? A l’exception de riverains lésés ou d’associations motivées ? Car il faut avoir du temps disponible et des connaissances techniques solides pour digèrer le pavé des documents soumis à l’enquête.
Le citoyen de base est-il conscient, devant son évier ou sa cuvette des WC, que commence le rivage de la mer Méditerranée, chez lui ? « Ici commence le rivage ». Les tuyaux qui partent de son logement aboutissent dans le golfe d’Aigues-Mortes, au large de Palavas, à 30 m de profondeur, via la STEU.
Raymond GIMILIO
Président de l’ODAM
Docteur en sciences biologique mention écologie
Ancien chargé d’études de haut-niveau au ministère de l’environnement (1980-1996)
Ingénieur de recherches (ER) du CNRS
Chevalier du mérite agricole (2015)

Le webmaster
Raymond GIMILIO

 Le projet du nouveau stade c’est environ 7ha d’emprise pour 25 000 places, en remplacement du stade actuel de la Mosson + Espaces dédiés aux événements accueillis et espaces dédiés aux activités complémentaires + Développement d’activité « in stadia » touristiques et commerciales : musée du sport, boutiques, hôtel, pôle tertiaires, etc…(coût du projet, environs 180 millions d’euros).
Le projet du nouveau stade c’est environ 7ha d’emprise pour 25 000 places, en remplacement du stade actuel de la Mosson + Espaces dédiés aux événements accueillis et espaces dédiés aux activités complémentaires + Développement d’activité « in stadia » touristiques et commerciales : musée du sport, boutiques, hôtel, pôle tertiaires, etc…(coût du projet, environs 180 millions d’euros).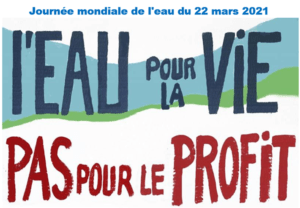
 L’usine « AMETYST » nous a été imposée par l’Agglomération. C’est une réalisation qui est dénuée de tout bon sens de par sa taille « Méga usine » et de son lieu de construction « en ville ». Elle est très onéreuse pour le contribuable et construite dans l’urgence par un industriel pour lequel on peut douter à la fois de son choix et de l’expérience nécessaire pour ce type d’usine.
L’usine « AMETYST » nous a été imposée par l’Agglomération. C’est une réalisation qui est dénuée de tout bon sens de par sa taille « Méga usine » et de son lieu de construction « en ville ». Elle est très onéreuse pour le contribuable et construite dans l’urgence par un industriel pour lequel on peut douter à la fois de son choix et de l’expérience nécessaire pour ce type d’usine.

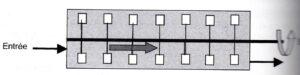



 Un objectif : recycler, réduire, réutiliser, réparer. zéro déchet zéro gaspillage.
Un objectif : recycler, réduire, réutiliser, réparer. zéro déchet zéro gaspillage. L’unité de Méthanisation « Amétyst » (ainsi dénommée par feu Georges Frèche) a été inaugurée en juillet 2017. Nous reproduisons ici une contribution de Jacky Chanton datée de décembre 2014. Nous pouvons mesurer, en 2021, le chemin parcouru.
L’unité de Méthanisation « Amétyst » (ainsi dénommée par feu Georges Frèche) a été inaugurée en juillet 2017. Nous reproduisons ici une contribution de Jacky Chanton datée de décembre 2014. Nous pouvons mesurer, en 2021, le chemin parcouru.



